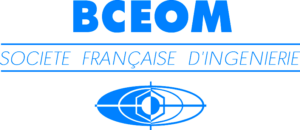Philippe Coutheillas est un ancien du BCEOM qui publie ses écrits sur son site www.leblogdescoutheillas.com. Il en extrait pour le site BCEOM-3A quelques textes s’inspirant, de façon romancée, de ses souvenirs au BCEOM.
Suite africaine n° 7
« Ayant achevé une mission d’un mois au Tchad, j’ai pris quelques jours de vacances avant de rentrer à Paris pour me rendre à Douala où habitait alors l’un de mes oncles, Jean. » Philippe Coutheillas
Cameroun 1969
1 – Le laitier
Ma mission au Tchad se termine. Un peu plus d’un mois à naviguer entre Fort-Lamy, Moundou et Fort-Archambault, je trouve que c’est largement suffisant. J’y ai pourtant vécu quelques moments intéressants: la chasse au phacochère au milieu des enfants cachés par les broussailles, la prison sur la place principale de Moundou avec ses femmes et les bicyclettes enfermées en plein air derrière un triple rang de barbelés, l’hôtel de Fort-Archambault avec son mainate siffleur de Marseillaises et ses hippopotames baillant devant la terrasse au milieu des pirogues sur le Chari, les crises vespérales de paludisme de mon chef de mission, debout dans sa toute petite piscine, un verre de whisky à la main agité de tremblements continus pendant près d’une heure, l’expédition au lac Tchad en Jeep Willys avec lui et la jeune ethnologue Françoise Claustre, un an ou deux avant son enlèvement par Hissène Habré, les deux petits lionceaux qu’elle voulait passer en fraude à son retour en France, le recrutement et la formation d’une vingtaine de tchadiens pour une enquête de transport pendant un an sur l’ensemble du territoire….Pour un premier séjour en Afrique noire, tout ça a été plutôt intéressant.
Mais j’ai hâte de retrouver Paris. Pourtant, je ne vais pas rentrer directement ; car j’ai téléphoné à Jean, mon oncle, qui habite Douala.
Très tôt, Jean a été pour moi une sorte de héros. Dans la famille, il bénéficiait d’une réputation mélangée et assez floue. Héros de guerre, séducteur, aventurier, généreux, colonialiste, charmeur, mystérieux, businessman, prodigue…tout pour plaire à l’enfant sage puis au raisonnable adolescent que j’étais. Je me souviens de ses retours d’Afrique avec ses arrivées tonitruantes en Facel Véga, ses cadeaux démesurés, sa bonne humeur perpétuelle et ses blagues africaines. Arrivé à Douala après quelques aventures plus ou moins mystérieuses, il avait créé une exploitation forestière du coté de Kribi, la Société Camerounaise de l’Azobé.
J’ai téléphoné à Jean et, bien sûr, il m’a invité à passer quelques jours chez lui et, naturellement, je n’ai pas résisté longtemps à son invitation.
L’avion qui effectue deux fois par semaine la liaison Fort-Lamy -Douala est un vieux bimoteur DC3 construit pendant la seconde guerre mondiale. On l’appelle l’avion laitier, sans doute parce qu’il s’arrête partout. Le parcours d’un peu plus de 1600 km, Fort-Lamy – Maroua – Garoua – Ngaoundéré – Yaoundé – Douala, lui prend toute la journée.
La première chose qui surprend quand on monte dans l’avion laitier, c’est la présence des gros quartiers de viande qui pendent du plafond de la carlingue. Il faut les écarter pour avancer vers le fond de l’appareil où se trouvent les places réservées aux passagers. La deuxième chose surprenante, c’est la forte pente de l’allée centrale qui vous fait dévaler vers votre siège. Enfin, votre siège lui-même vous surprend à son tour : il a l’air d’avoir été récupéré sur une 2CV des années cinquante.
Le moteur droit cafouille un temps, lâche un petit nuage noir, puis s’emballe en chassant vers l’arrière des panaches de fumées bleues. Le moteur gauche démarre plus facilement. Le bruit est infernal. La carlingue tremble. L’avion pivote sur place et roule vers la piste derrière un Boeing 707 d’UTA qui rentre sur Paris. Le DC3 attend son tour en vibrant. Sur un signe invisible, il reprend sa course vers le bout de la piste d’envol, accélère dans le virage et décolle lentement. Je regarde vers le bas et je reconnais la case du chef de mission avec sa Jeep et sa petite piscine carrée. La ville disparaît rapidement sous l’aile droite. Elle laisse la place à la terre ocre, parsemée d’arbustes et de petites cases, striée de sentiers en tous sens. L’ombre de l’avion traverse le fleuve. Nous sommes au Cameroun. Terre ocre, arbustes, cases, sentiers…
Le vol se passe sans encombre, dans les odeurs mélangées de viande, d’essence et de gaz d’échappement. Pas de service à bord, bien sûr, mais j’arrive à manger quelque chose dans l’aérogare de la capitale, Yaoundé.
À Douala, pour parvenir jusqu’à l’aérogare, le petit avion zig-zague entre les Caravelles, les DC6 et les Boeing 707 d’UTA, Air Afrique, Lufthansa…
2 – L’amour qui passe
Jean est là, à la descente de l’avion, souriant, joyeux, volubile, superbe, Jean. Il est accompagné du chef d’escale. Nous traversons les contrôles de police et de douane avec un simple petit signe de tête aux fonctionnaires. Quand nous arrivons à sa voiture, il a déjà rencontré une dizaine de connaissances, noirs ou blancs, avec lesquels il a plaisanté ou échangé quelques mots.
Il m’emmène directement aux Cocotiers, le seul hôtel de luxe de la ville. Je prendrai une douche et il viendra me rechercher pour diner « à la case » avec sa deuxième épouse, Michèle, que je connais à peine.
Le repas terminé, Jean décide d’aller prendre un verre dans une boîte de nuit. Michèle renâcle un peu, mais finit par céder pour ne pas paraître gâcher la soirée. Je comprendrai vite qu’elle n’aime pas beaucoup l’Afrique.
Jean semble aussi connu dans la boîte que dans l’aéroport. La clientèle est mélangée, noirs et blancs, et beaucoup viennent lui dire bonjour. Michèle garde les lèvres serrées.
Jean décide de rentrer de bonne heure car, dit-il, nous partirons pour Kribi aux aurores demain matin. Il n’est pas encore minuit, mais ma journée a été longue depuis Fort-Lamy, et je suis content de rentrer à l’hôtel. Au moment où je vais me coucher, on frappe à la porte.
– Qu’est-ce que c’est ?
– C’est l’amour qui passe, patron !
C’est une des filles qui tournent en mobylette devant l’hôtel. Elle a dû voir s’allumer la lumière de ma chambre et elle tente sa chance…
3 – La piste
Jean est à la réception des Cocotiers vers cinq heures et demie, mais il prend le temps de nous offrir un superbe petit déjeuner. Quand nous montons dans sa voiture, il fait grand jour. C’est une DS19, à cette époque probablement la meilleure voiture pour l’Afrique, mais encore peu répandue dans ce qui est encore une chasse gardée de Peugeot.
Le ciel est bas et gris. Il a dû pleuvoir fort ce matin car la piste est détrempée. A travers les faubourgs de Douala, nous dépassons les pick-up, les mobylettes et les vélos à coups de Klaxon en projetant autour de nous des gerbes de boue rouge. Personne ne semble protester. Les derniers commerces, les derniers hangars et les dernières cases disparaissent et Jean accélère. Il y a peu de circulation. Nous croisons régulièrement de très gros grumiers. Ils ne portent que deux ou trois billes de bois, rarement plus, mais elles sont énormes. Beaucoup de ces camions penchent sur le côté sous le poids de leur charge mal centrée. A chaque fois que nous croisons un tel engin, Jean ralentit et s’en écarte le plus possible. Il m’explique qu’il y a beaucoup d’accidents provoqués par ces énormes troncs d’arbres qui tombent parfois sur la route ou sur les voitures.
Bien sûr, dans une DS de 1969, il n’y a pas d’air conditionné, mais avec la vitesse et les grandes fenêtres ouvertes, c’est supportable. Nous passons Edéa, son pont allemand et son usine d’aluminium où je reviendrai dans trente ans pour un accident de four. La forêt commence et la piste en légère surélévation devient de plus en plus boueuse. Une heure plus tard, nous passons sur le pont métallique qui avait glissé sur ses piles lors du freinage d’un grumier, isolant l’exploitation de Jean pendant plus d’un an et le conduisant au bord de la faillite. Maintenant, le pont est à nouveau en place et les affaires vont mieux.
Peu après, nous quittons la piste principale pour nous enfoncer dans la forêt sur une sorte de chemin d’exploitation étroit creusé dans la boue par les camions grumiers. Les arbres sont immenses. Jean me précise que c’est de l’Azobé, bois lourd et imputrescible sur lequel il fonde beaucoup d’espoirs. Quand nous avons ralenti pour quitter la piste principale, il a fermé sa fenêtre et m’a demandé d’en faire autant pour éviter que la voiture ne soit envahie de mouches.
4 – Sylvie
Finalement nous arrivons dans une clairière. C’est le campement : une jeep et quelques camions au milieu de quelques baraques. La construction la plus avenante est un petit hangar bardé et couvert en tôles ondulées. C’est l’atelier de mécanique. Nous descendons de voiture et sommes immédiatement attaqués par les mouches. Au début, on se dit qu’on ne pourra jamais supporter ça plus de deux minutes et puis, faute de pouvoir faire autrement, on s’y habitue. Il faut pourtant réfléchir avant d’ouvrir la bouche. Quelques noirs viennent dire bonjour au patron et à son neveu, puis ils se rassemblent autour de la voiture et restent à la regarder dans un silence admiratif. Au bout de quelques instants, un blanc sort du hangar en tôles. Il est petit, très petit, et costaud. Il porte une casquette à grande visière, un maillot de corps sans manches rentré dans un pantalon court qui lui arrive à la hauteur des genoux. L’ensemble est sale et couvert de transpiration : lui, sa casquette, son maillot de corps et son pantalon. Jean me présente l’homme : c’est Marco, responsable de l’exploitation, moitié portugais, moitié belge. Il vit là trois ou quatre mois de suite, puis il va passer une petite semaine à Douala pour se civiliser un peu. Il revient ensuite à l’exploitation pour trois ou quatre mois de plus en forêt. Il n’a pas quitté le Cameroun depuis quatre ans. Il accumule salaire et jours de congés pour quand il partira, comme il est venu, sans savoir ni quand ni pourquoi.
Jean a une brève conversation avec Marco. Ils parlent de l’état du matériel, de la réparation du gros chargeur, toujours pas faite faute de pièces, de l’accident du mois dernier et de l’état du blessé en convalescence à Kribi et du déplacement du campement qu’il va falloir prévoir bientôt. Jean demande gentiment à Marco des nouvelles de Sylvie. Marco dit qu’elle est un peu capricieuse ces temps-ci, mais qu’elle va bien.
-Venez la voir, nous dit-il, en nous invitant du geste à le suivre vers une des baraques, sa maison.
Nous entrons chez Marco. La pièce unique est sombre, en grand désordre, et envahie de mouches. Elle est meublée d’une table, d’une chaise, d’un réfrigérateur à alcool, d’une cantine métallique et d’un grand lit à baldaquin recouvert d’une moustiquaire. Une chaîne est accrochée à l’un des montants du lit. Au bout de la chaîne, attachée par un beau collier de chien, il y a Sylvie.
C’est une guenon.
Philippe COUTHEILLAS, juillet 2022