Écologiste avant l’heure ?
Tout commença le 14 février 1979 à 9h, date à laquelle une connaissance m’informa qu’un bureau d’étude cherchait un spécialiste en environnement. À 10 h, alors que je venais de passer mon doctorat en biologie marine à l’Université de Montpellier, je me présentai à La Grande Motte, au mythique « Bureau Central d’Études pour les Équipements d’Outre-Mer », dont l’intitulé me faisait penser à « Universal Export », la société fictive qui couvre les agissements de James Bond à l’international… À 11h00, après une discussion courtoise sur mes compétences, j’étais recruté, avec l’intitulé « Écologiste » (sic) sur ma feuille de paie, une première dans un bureau d’étude français ! Et je fus lâché dès le lendemain sur le projet d’élargissement du canal du Rhône à Sète pour en conduire l’étude d’impact. Nous n’avions pas encore le fax, je ne parle même pas d’internet, mais certaines choses allaient plus vite qu’aujourd’hui ! J’étais très vite encadré et formé par un trio d’experts aux compétences et aux personnalités très différentes : Max GERVAIS, spécialiste en assainissement et très fin commercial sur le plan local, Henri DUMAY, l’expert hydraulicien maison, et Bernard ORSAT, architecte-urbaniste.
La loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976 avait introduit l’étude d’impact sur l’environnement, une véritable révolution quand on sait que les projets n’étaient alors justifiés que par des raisons strictement techniques et économiques, vaguement socio-économiques et occultant simplement les externalités environnementales. Le début des années 1980 était donc marqué par la montée en puissance des études d’impact sur l’environnement, qui venaient évidemment contrarier les porteurs de projets. Le BCEOM fut donc novateur en prenant très tôt en compte la composante environnementale dans ses projets d’équipements.
En dehors des méthodologies balbutiantes – que nous nous efforcions de construire –, la principale difficulté était de convaincre les maîtres d’ouvrage de l’utilité de cet outil, en dehors de son obligation purement règlementaire. Il m’a fallu être très déterminé et pédagogue pour que cette démarche soit acceptée et partagée, y compris auprès des ingénieurs de BCEOM pour qui l’environnement était loin d’être la préoccupation première.
A la droite de Dieu
Mes débuts furent donc difficiles, à preuve une réunion surréaliste où j’expliquai au subdivisionnaire de la DDE de Bédarieux, l’intérêt d’élargir une route du côté opposé à un cours d’eau où il comptait déverser tranquillement les remblais en étouffant la végétation de la rive et en colmatant le lit de la rivière. Mon interlocuteur qui s’appelait Monsieur DIEU, je n’invente pas – c’est la seule fois dans ma vie temporelle où je fus assis à la droite de Dieu et j’espère que la prochaine fois sera le plus tard possible –, mon interlocuteur donc s’emporta et me pria quasiment manu militari de quitter la salle, s’offusquant qu’un « environnementaliste » puisse oser intervenir sur un sujet aussi technique et lui dicter le tracé de « sa » route.
S’ensuivit donc une période intense d’apprentissage où je m’exerçais à l’évaluation environnementale des projets de routes, aéroports, stations d’épuration, ouvrages hydrauliques, ports et aménagements littoraux, etc. qui me permirent, grâce à un premier contrat, de rédiger plusieurs guides méthodologiques pour le ministère de l’Environnement. J’assistais alors l’Atelier central de l’environnement qui était la cheville ouvrière du ministère pour la méthodologie des études d‘impact, ce qui me permit d’affiner grandement mon expertise.
Je n’ai pas encore été partout, mais c’est sur ma liste.
À la vue de certains collègues qui revenaient bronzés de destinations mythiques (Philippines, Bali, Pérou, Kenya, Madagascar…), me vint alors très vite l’envie d’expérimenter les missions à l’étranger où BCEOM excellait et réalisait la plus grosse part de son chiffre d’affaires. J’en parlai d’abord à la division ADR (Aménagement et développement Rural) qui était aussi localisée à la Grande Motte et qui me mit le pied à l’étrier pour une étude sur la lagune de Bardawill, dans le Sinaï. Les appels d’offres des différents bailleurs intégraient maintenant des critères environnementaux et impliquaient de compléter les équipes par des spécialistes en évaluation environnementale. J’allai donc Square Max Hymans, siège du BCEOM, me faire connaître auprès des patrons des divisions internationales (RIN, RAO, PVN, …) pour proposer mes services. Il me fut facile de les rencontrer : il faut dire que la structure « managériale » – on n’employait pas ce barbarisme à l’époque –, était simple et efficace, sans organigramme alambiqué et modifié périodiquement. Il y avait des divisions avec un patron et « en râteau », les différents ingénieurs et économistes. Les patrons étaient certes des gestionnaires, mais ils étaient avant tout impliqués commercialement et présents sur leurs terrains respectifs.
Plus que les missions techniques que j’enchaînais dans les années 90, c’est l’art du voyage que je privilégiais, pas celui du tourisme, mais plutôt celui qui donne le temps de la rencontre et de l’échange avec les clients locaux, les parties prenantes et la population tout simplement. Une façon de voir le pays « à l’envers ». J’aurai l’occasion de revenir sur ses missions dans les prochaines éditions de ce blogue.
La romancière américaine Susan SONTAG écrivait : « Je n’ai pas encore été partout, mais c’est sur ma liste ». A contrario, voici la mienne, celle des missions-voyages que j’ai effectués, par ordre chronologique : Égypte, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Thaïlande, Koweït, Bangladesh, Argentine, Uruguay, Guinée, Philippines, Ukraine, Kenya, Jamaïque, Tunisie, Maroc, Malte, Turquie, Ethiopie, Gabon, Bénin, Espagne, Portugal, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Pologne, Suède, République Tchèque, Guatemala, Sénégal, Cap Vert, Canada… À la fin, je me suis un peu embourgeoisé : Ile Maurice, Tahiti, Monaco (Il me manque Gstaad en Suisse…).
Inverser le regard
Vint le temps où l’on me confia la tâche de constituer une équipe pour faire face aux nombreuses demandes internes et externes d’évaluation environnementale des projets. Je me consacrais donc à recruter de manière durable, non pas dans le sens de conserver des collaborateurs ad vitam aeternam, mais plutôt d’en faciliter l’essaimage au sein de BCEOM.
Plus tard, Directeur du département « Environnement et Développement durable » dans une filiale du groupe Egis qui a absorbé BCEOM, j’ai animé une équipe d’une quinzaine d’ingénieurs spécialisés en évaluation environnementale des grands projets d’infrastructures.
BCEOM m’a permis de comprendre les différents métiers de l’ingénierie, indispensable pour convaincre de l’intérêt d’inverser le regard sur les projets en utilisant l’environnement comme levier pour un aménagement durable et harmonieux. Un objectif rendu possible par la grande liberté d’action – certes bridée par la feuille d’imputation ! – qu’autorisait cette société à forte valeur ajoutée par sa dimension humaine.
… suite dans le prochain blog
Patrick MICHEL, mai 2021


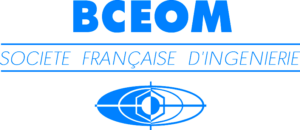
Ayant eu le plaisir, et parfois la douleur, de travailler sous la direction de Patrick Michel de 1990 jusqu’à sa retraite (et ce n’est pas fini), je confirme (presque) tout ce qui est dit ci-dessus, pour la période récente.